La propriété de La Rivière à Nantes et ses 18 hectares de jardins paysagés
Mon grand-père Charles-André dans son bureau des pépinières Caillé.
Nantes fut longtemps l’une des villes les plus attrayantes de France. La cause principale fut d’abord l’import et l’export des métaux puis la traite négrière, dont elle n’a pas à s’enorgueillir, et qui déversaient beaucoup d’or dans les coffres, si bien que des réceptions fastueuses s’y succédaient dans les hôtels de ces Messieurs du commerce comme l’était l’hôtel Henri IV, ouvert en 1788 sur la place Graslin et qui comptait 60 chambres. Arthur Young dut y faire un séjour inoubliable, car cet anglais en fait une description enthousiaste dans Voyage en France. « Je ne sais si l’hôtel Henri IV n’est pas la plus belle auberge de France. »
« D’où vient-il que cette ville qui n’est pas immense, constituée au trois-quarts d’immeubles de sous-préfecture (…) donne si fortement le sentiment d’une « grande ville » ? – interroge à son tour Julien Gracq dans « La Forme d’une ville ». « Peut-être de ce qu’elle est, plus impérieusement qu’une autre, centrée sur elle-même, moins dépendante de ses racines terriennes et fluviales…» – répond-t-il. Et c’est vrai que l’on ne comprend pas Nantes si on ne la regarde pas comme une ville étrangère à sa propre région, comme une cité farouche et frondeuse, ouverte davantage sur les pays du Nouveau monde que sur les banlieues rurales trop occupées à coudre à petits points la vie quotidienne. Il faut à Nantes l’aventure, les terres lointaines, les grands souffles, les lendemains qui chantent ou déchantent mais s’irriguent d’une énergie insatiable. Ville de défis et de modernité, elle a toujours souhaité être différente et s’est nourrie de cet orgueil. Nantes, à la veille de la Révolution, était avec ses 90.000 habitants la plus grande ville bretonne, également la plus remuante, la plus ambitieuse, en quelque sorte la plus extrême, tant et si bien que nos rois ont toujours eu à cœur de l’amadouer. C’est ce que fit Charles VIII qui vint y déclarer sa flamme à la duchesse Anne âgée de 15 ans et, par la même occasion, annexer la Bretagne à la couronne de France.
Aujourd’hui où les villes s’étendent jusque dans les campagnes, où les usines s’implantent jusque dans les champs, où les publicités s’affichent jusque sur les murs des étables et des granges, l’existence se nivelle de même façon. L’espace perd de son importance, il se noie dans un flou où les idées elles-mêmes ne se reconnaissent pas. On ne sait plus où commencent et finissent les choses et à qui elles appartiennent. Mais en 1780, l’existence s’écoulait encore à la mesure du pas de l’homme. Elle avait cette lenteur majestueuse qui confère aux gestes leur signification. Le premier Charles Caillé de la lignée, ayant le goût de l’aventure et du commerce, avait quitté sa modeste cité de St-Laurent-le-Vieil pour s'engager dans une existence plus aventureuse, tout en conservant son amour des choses qui envoûtent : les arbres, les plantes et les fleurs. Ce devait être un poète comme le furent son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils mon grand-père, des hommes qui avaient par-dessus tout l’amour du terroir, le souci de léguer un art de vivre et de contempler ce qui nous a été donné de meilleur : la nature.
La plaque relatant la donation du parc Procé à la ville de Nantes.
Le parc Procé de nos jours.
Nantes est la ville de mes ancêtres depuis le XVIIIe siècle. La lignée des Charles Caillé, commencée en 1780, ne s’éteindra qu’avec la disparition de mon grand-père en 1945. La ville de Nantes doit le parc Procé à un cousin de mon grand-père Gustave Caillé, né en 1824 et mort en 1894 qui était négociant en matériaux et dont les descendants, dont le célèbre poète et avocat Dominique-François Caillé (1856 – 1926), en feront don à la ville en 1905 pour la somme symbolique de 320.000 frs. Ce magnifique jardin, acheté en 1866 par Gustave, sera réaménagé par l’architecte-paysagiste Dominique Noisette et conserve aujourd’hui encore la physionomie qu’il avait autrefois. Durant la guerre de 14/18, il sera utilisé en partie pour remédier à la pénurie de nourriture et des parcelles seront plantées de pommes de terre grâce à la main d’œuvre des prisonniers. Mon grand-père déplorera toujours que le parc Procé n’ait pas été dessiné par un Charles Caillé mais, à l’époque, si mon arrière-grand-père avait admirablement développé les pépinières de la famille, il n’était pas lui-même architecte. Par esprit de compétition, il incitera son fils à entrer aux Beaux-Arts et à le devenir afin de créer à son tour, quelques années plus tard, les magnifiques jardins de La Rivière, près du pont de Cens, sur 18 hectares de terrain. Ces jardins comprenaient toutes les expressions qu’ils peuvent revêtir selon les lieux et les préférences végétales de la nature et étaient réputés dans la région : on y découvrait, au gré des allées, les jardins à la française, à la japonaise, à l’anglaise, le jardin hollandais, alpin, italien, distribuant, comme dans les tableaux de maître, des touches d’ombre et de couleur qui révélaient un incontestable talent – écrivait Monsieur Grand dans un long article de la revue d’horticulture française consacré aux jardins et pépinières de la Rivière. Et il poursuivait :
« Au nombre des maisons nantaises qui se sont spécialisées, avec un rare mérite, dans ce domaine si captivant des pépinières et de l’architecture paysagère, l’une d’elles, consacré par un siècle et demi d’expérience, retient aujourd’hui notre attention, nous avons nommé la maison Charles Caillé. Le côté historique du sujet nous fait remonter le cours des ans jusqu’au règne de Louis XVI, en 1780 pour être précis. C’est à cette époque, en effet, que M. Charles Caillé fondait ses premières pépinières, berceau de la splendide exploitation d’aujourd’hui. Depuis cette date, collaborant tour à tour au bel édifice de l’Horticulture Française, les fils aînés de la famille qui, selon une tradition, portèrent tous le prénom de leur ancêtre, continuèrent avec clairvoyance et droiture l’œuvre de leur aïeul. (…) Ces pépinières de la Rivière, entièrement conçues et réalisées en dix ans, sous la direction de M. Charles André Caillé, après de formidables travaux de terrassement, révèlent à nos yeux émerveillés, comme une immense carte d’échantillons, tout ce que peut réaliser la science du pépiniériste à chacun de ses stades, alliée à la technique de l’architecture paysagiste. (…) L’architecte paysagiste, vraiment digne de ce nom, unit à une vaste expérience, à des connaissances techniques longuement acquises, cette sorte d’instinct divinatoire qui anime toute son œuvre et nous fait dire : que c’est beau ! Loin d’essayer de dompter, d’asservir la nature, le jardinier d’art puise au contraire dans ce modèle éternel et toujours jeune les plus précieux enseignements. C’est à son école qu’il apprendra cet art prestigieux des transitions qui consiste à raccorder son œuvre au paysage environnant, c’est elle qui lui enseignera à distribuer ces touches d’ombre et de lumière qui révèlent le réel talent. C’est la Nature qui lui apprendra enfin à orchestrer sans heurt, à réunir dans une même symphonie un ensemble de paysages idéalisés et poétisés, en un mot à composer un jardin. (…) Signalons notamment une collection unique de quatre cents conifères, la merveilleuse roseraie qui réunit près de deux mille espèces, le jardin fruitier, l’arboretum dont M. Charles Caillé fait volontiers les honneurs aux jeunes élèves des écoles d’horticulture. Les Pépinières de la Rivière se sont également spécialisées avec infiniment de soin dans la culture des bambous, cette superbe graminée tropicale aux belles cannes luxueuses, aux feuilles persistantes en toute saison et qui est sans contexte un des plus beaux ornements de nos jardins. Ce sont des spécimens des espèces les plus recherchées que les établissements, que nous étudions, expédient comme les autres plantes dans toute la France et à l’étranger. (…) Ajoutons quelques mots sur ces services d’expédition dont nous venons de parler qui sont précisément situés au voisinage du siège social, des bureaux d’études et de devis, rue du général Buat, emplacement centenaire des pépinières Charles Caillé avant la création du domaine de la Rivière.(…) Qu’il nous soit permis, en terminant, d’adresser nos félicitations à M. Charles Caillé pour ses splendides réalisations des pépinières de la Rivière, pour leur bel ordonnancement, pour les soins attentifs et continuels, cette sorte de tendresse, dirions-nous volontiers, qu’il témoigne aux choses de sa profession, justifiant de la sorte une réputation de loyauté dans les transactions, de progrès technique conformes aux traditions les plus séculaires de la maison. »
Mon grand-père enfant. Tombé d'un arbre à 9 ans, il avait un oeil de verre.
Assis, mes arrière-grands-parents Alexandre et Aimée Justeau. Derrière eux, de droite à gauche, leur fille Jeanne, leur gendre Charles et leur fils officier.
Le drame de mon grand-père fut d’avoir épousé une femme qui ne partageait pas ses goûts, mariage arrangé par les familles et qui unissait, pour le pire, le rat des villes et le rat des champs. Ma grand-mère était aussi peu rurale que possible, elle n’entendait nullement s’investir dans la culture des magnolias, des roses et des camélias, cette fleur dont l’aînée de ses belles-sœurs connaissait tous les secrets, au point qu’à Nantes on l’appelait « mademoiselle camélia », et qu’elle l'obligea à sortir du couvent pour venir prêter main forte à son malheureux frère. Le couple ne fut pas long à battre de l’aile malgré la naissance de deux filles, l’aînée Yvonne et la cadette Jeanne, ma mère, qui ne semblaient, ni l’une, ni l’autre, avoir été sensibilisées par leur mère à l’art si délicat des jardins et des fleurs. De plus, n’ayant que deux filles, le dernier des Charles Caillé ne pouvait léguer à un fils, qu’il aurait appelé Charles bien entendu, ce magnifique patrimoine, bien qu'il ait toutefois tenté d’initier ma tante Yvonne au secret de l’horticulture comme il l’avait fait pour sa sœur aînée Charlotte. Hélas ! sa femme allait bientôt l’obliger à une séparation, suivie d’un divorce, alors que leurs filles n’avaient que 19 et 15 ans. Ce fut un drame pour mon grand-père qui, malgré tous les recours possibles du cœur et de l’esprit, ne parvint pas à raisonner son épouse. Il est vrai que leurs tempéraments, comme leur éducation, étaient à l’opposé l’un de l’autre et que la famille Caillé, austère et pieuse, ne parvint jamais à éveiller un quelconque intérêt chez une jeune femme dont la famille aimait davantage le luxe et les mondanités. Les trois soeurs de mon grand-père étaient restées célibataires, toutes trois consacrées à la famille, à leur foi religieuse et à leur implication dans l’entreprise familiale. La rupture se fit de façon implacable de la part de ma grand-mère qui exigea que ses filles ne revoient jamais leur père qu’elle jugeait taciturne et colérique. Comme elles étaient jolies et auréolées d’un nom connu à Nantes, elles n’eurent pas de peine à trouver des maris à une époque où le divorce avait très mauvaise presse et jetait l’opprobre sur toute une famille. Ni mon grand-père, ni ma grand-mère ne se remarieraient d’ailleurs.
L'une des trois soeurs de mon grand-père, la plus jolie : Juliette. Elle consacrera sa vie à sa mère, à son frère, à Dieu et aux fleurs.
Ma grand-mère et ses deux filles.
En 1941, ne pouvant assurer sa succession, mon grand-père se vit dans l’obligation de vendre cette affaire, qui était sa fierté, à un certain monsieur Kaczorowski. Les pépinières seront alors abandonnées et le château de la Rivière dynamité par les Allemands le 12 août 1944. Reconstruit après la guerre, il ne sera pas de même ampleur et, en 1956, M. Kaczorowski, ne pouvant utiliser à son usage les 18 hectares de terre, les vendra pour la création d’un lotissement de pavillons individuels, appelé aujourd’hui « le lotissement de la Rivière ». Mon grand-père, mort en 1945, à l’âge de 68 ans, n’eut pas à assister au bétonnage inéluctable de ses anciens jardins mais la douleur d’abandonner le flambeau que des générations s’étaient transmis depuis près de deux siècles. Ses trois sœurs resteront seules, à l’abri du besoin certes, et n’en voudront jamais à leurs nièces de leur attitude et comportement en vraies chrétiennes qu’elles étaient, supposant que la mère était la seule responsable. Je me souviens très bien de mes grandes tantes, ces vieilles dames nourries de culture botanique qui m’entouraient de leur tendresse, me couvraient de cadeaux – spécialement des livres sur la vie édifiante des saints et des bienheureux et d’innombrables images à leur effigie – lorsque, nous rendant sur une plage bretonne, nous faisions un détour par Nantes et allions leur rendre visite, leur frère ayant gagné le jardin éternel.
Quant à ma grand-mère, elle semblait vivre hors du temps. Bien qu’assez quelconque sur ses photos de jeunesse, elle était devenue belle en vieillissant, sa minceur lui conférant une allure altière et ses cheveux blancs une indiscutable distinction. Pour ne pas rester seule après le mariage de ses filles, elle s’était installée auprès d’elles à Paris avec une dame de compagnie, qui n’était autre que la seconde femme de son frère, une ancienne religieuse qui était sortie du couvent pour élever les trois enfants en bas-âge de cet officier qui avait eu le malheur de perdre, quelques années auparavant, sa jeune femme de 25 ans de la typhoïde. Bien qu’inconsolable, il lui avait fait un enfant, puis était parti guerroyer sur divers fronts avant de mourir, au détour de la cinquantaine, d’un cancer. Les deux femmes s’entendaient bien, d’autant mieux que la belle-sœur se chargeait des tâches ménagères et que ma grand-mère pouvait ainsi passer des heures gourmandes dans les salons de thé. Elle adorait les salons de thé et Paris n’en manque pas.
Lorsque les choses se gâtèrent en 1942, toutes deux partirent se réfugier à Buxières-les-Mines près de Moulins, où vivaient les parents de la belle-sœur, ayant à leur disposition, contrairement aux parisiens, des poules, des lapins, un potager et un verger pour assurer leur alimentation. C’est ainsi que l’on m’envoya petite y passer plusieurs mois pour arrondir ma silhouette qu’affligeait une maigreur inquiétante. J’étais, en effet, une enfant malingre, aux genoux cagneux, que l’air de la campagne, la découverte des fruits et du lait allaient remettre sur pied. En 1945, trois mois après m’y avoir conduite, mes parents vinrent me rechercher à bicyclette, retrouvant une petite fille aux joues roses et aux genoux moins cagneux. Je me souviens du plaisir que j’avais alors à manger, découvrant les tartes aux fruits, les légumes frais et surtout les laitages comme le riz ou le tapioca dont je léchais les casseroles avec gourmandise pour y apprécier le goût de caramel laissé par les céréales que ma grand-mère avait oubliés sur le feu. Je découvrais également, quelques années avant le Rondonneau, les fleurs, les arbres, les oiseaux, la nature si peu présente à Paris et l’orage dont la foudre tomba un soir sur le clocher du village, suscitant une peur tout aussi grande que celle des sirènes ou du passage des bombardiers allemands qui terrorisaient mes nuits d'enfant.
Ma grand-mère mourut un an après son mari, en 1946 à l’âge de 65 ans, et ses obsèques furent célébrés avec faste en l’église Saint-Augustin. Ma cousine et moi suivions le corbillard, tout vêtues de noir, à travers les rues de la capitale qui conduisaient de son appartement à la lourde église parisienne. Bien sûr, je pleurais car j’aimais bien ma grand-mère qui venait souvent passer de longs moments à la maison et avec qui j’avais partagé les heures printanières de Buxières-les-Mines. Mais de mon grand-père, si talentueux, amoureux de la musique et des fleurs - il avait orienté ma mère vers le conservatoire de chant - je n’ai pratiquement rien su car on ne parlait jamais de lui dans la famille. Son absence m’a laissé un vide immense. Cet aïeul aux mains vertes, je l’ai cherché et recherché après la disparition de ma mère, ayant enfin accès aux archives familiales, interrogeant mes cousines, ma tante, qui a quitté ce monde plusieurs années après ma mère et s'est montrée plus loquace sur ces vieux jours, lisant et relisant les lettres, les articles de journaux et, grâce à internet, ayant accès à des documents et photos qui ont confirmé mes impressions. Voilà, cher grand-père, l’hommage que je voulais rendre à ton parcours admirable, à ton talent vanté par tes contemporains ; n'as-tu pas ta rue à Nantes, près du pont de Cens*, en reconnaissance des immenses services que tu as rendus au jardin des Plantes de Nantes et à la beauté des jardins que tu as créés à la Rivière. Quant à moi, je salue ton sens du devoir, je m'émeus du souci que tu n’as cessé de te faire au sujet de tes filles, de ton chagrin de les voir s’éloigner et d’avoir tout perdu à la suite de ce divorce qui t’a contraint à vendre la Rivière et à ne pas transmettre à un gendre ou à ta fille aînée l’œuvre de plusieurs générations de jardiniers d’art. Mais vois-tu, il s’est passé quelque chose qui me console un peu, mon père a souhaité que sa femme repose dans le caveau familial au cimetière Saint-Donatien de Nantes, où il l’a rejoint l’année suivante. Alors, vois-tu, grand-père, ta plus jeune fille a fini par rentrer à la maison pour y reposer en paix.
ARMELLE
* Il existe également une rue Marie-Biton Caillé, membre de notre famille, dont les terres s'étendaient depuis l'actuelle avenue Charles Caillé jusqu'à la rue du général Buat où se tenaient les bureaux des pépinières, soit au N° 15 de cette artère. La dénomination "Avenue Marie-Biton Caillé" a été officialisée par une lettre d'autorisation du maire Paul Bellamy en date du 22 novembre 1924 adressée à Charles Caillé qui avait présidé lui-même à l'aménagement de cette voie sur ses terrains.
Pour consulter la liste des articles de la rubrique "ARTICLES ME CONCERNANT, cliquer ICI
Et pour prendre connaissance des articles relatifs à l'histoire de ma famille, cliquer sur leurs titres :
Mon père, retour sur le passé
Ma mère à la lumière des souvenirs
Arthur, mon arrière grand-père, une histoire simple
Le Rondonneau, retour à ma maison d'enfance
Renée ou l'enfance réenchantée
Les Pâques de mon enfance au Rondonneau
Les chiens de mon enfance
Le cercle de famille
Chers disparus
RETOUR A LA PAGE D'ACCUEIL
Ma grand-mère et ses deux filles dans le parc de La Rivière.








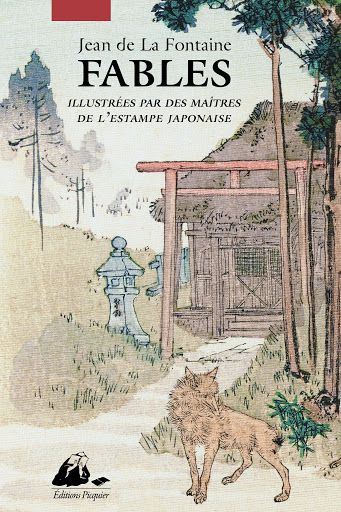





/image%2F1426042%2F20200925%2Fob_6bb00b_telechargement-1.jpeg)
/image%2F1426042%2F20150219%2Fob_f8f819_dsc-0508.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_25651c_dsc-0519.JPG)
/image%2F1426042%2F20150331%2Fob_986b27_dsc-0695.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_4dfb28_dsc-0446.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_9bcac8_dsc-0448.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_0c2b69_dsc-0457.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_ca141a_dsc-0497.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_d75bcb_dsc-0460.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_7e3674_dsc-0506.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_c42b9a_dsc-0470.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_a72530_dsc-0511.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_d43b88_dsc-0494.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_db77e5_dsc-0509.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_49d690_dsc-0477.JPG)
/image%2F1426042%2F20150303%2Fob_a91407_dsc-0503.JPG)




























